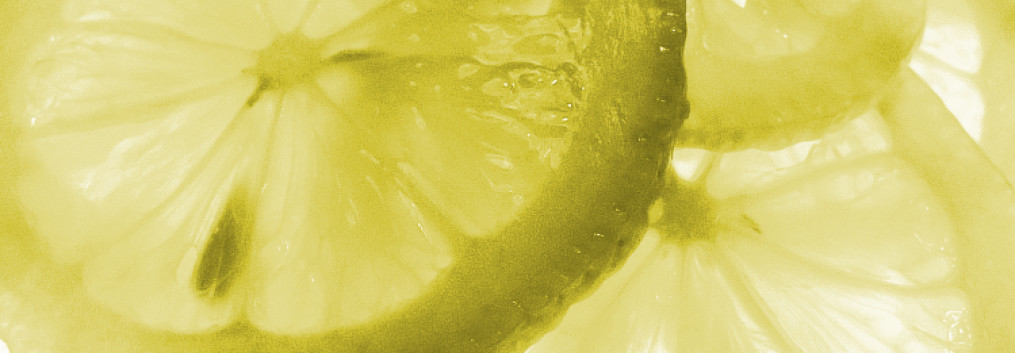J’aime particulièrement recevoir des réponses à ce que j’écris.
Il y a quelques jours, j’ai reçu d’une amie française un mail. Elle m’y disait avoir beaucoup apprécié le dernier poème que j’ai publié. Il lui avait inspiré un court texte qui n’est pas une nouvelle mais plutôt son ressenti face aux déchirures que l’on est obligé de connaître lorsque l’on vit. Après discussion, elle est d’accord pour que je le publie. Le voici, donc. Lire la suite
Lunaire Sextidécan
Quand on y pense, il y a de quoi pleurer.
Dans un pays que Platon aurait voulu gouverné par les philosophes rois, le peuple perd tout. Il n’aura bientôt même plus ses yeux pour pleurer. Certains n’ont déjà plus que le choix de leur mort. Les plus jeunes, ceux qui ont encore un avenir à défendre, hurlent à la vengeance. Ils sont prêts à lutter contre cette crise qu’ils n’ont pas méritée et encore moins voulue.
Et cette vague qui recouvre la Grèce lèche déjà les côtes de nos habitudes. À l’horizon de nos vies, l’avenir est plus flou encore qu’auparavant. Le monde tremble sous les coups de ces hommes que j’imagine si peu humains. Du genre à changer l’or en argent.
Même le ciel bleu n’est plus un refuge, puisqu’il cache quelque blessure faite par notre inconscience. Il pèse sur nous de toute sa légèreté. Souvent je l’ignore. Il se ternit quand j’y pense. Au loin, une couronne de pollution sacre et ceint Bruxelles. Tout le monde est touché. Ceux qui n’y sont pour rien peut-être plus que les autres.
Et puis, il y a partout des amis qui se déchirent, des amants qui se défont, des êtres qui s’en vont.
Pour ne pas y penser, il y a de quoi se leurrer.
Il y a cent moyens de se saouler. Pas besoin de tous les citer. Les moyens varient selon les envies. Chacun dispose de ses propres ivresses qui permettent d’oublier le quotidien sordide. S’enivrer permet de garder la tête hors de l’eau, de surnager, de survivre. Au final, il ne s’agit que de prendre suffisamment de distance avec le monde ; éviter de se faire absorber.
Les rares sobres découvrent la réalité dans tout ce qu’elle a d’absurde. Ils entrevoient la voie sur laquelle nous sommes engagés. Face à une telle révélation, il faut s’accrocher. On peut alors décider de s’en foutre ou de faire changer les choses. Quoi qu’il en soit, quand on décide d’une attitude face au monde, il vaut mieux ne pas vaciller. Le monde, c’est une force assez effroyable. Il faut avoir ou les deux pieds sur terre ou aucun, sinon on bascule et on se retrouve les autres fers en l’air.
Et malgré tout cela (et grâce à tout cela), on est heureux.
On ne fait pas exprès. C’est juste qu’on en a l’habitude. Parce que ça pourrait être pire et que ça ne l’est pas. Qu’après tout, la misère, elle est loin. Que si même la nuit il fait si clair, c’est que tout n’est pas si sombre qu’on le pense. La nouvelle lune est loin des esprits quand l’astre se montre en entier dans le ciel nuageux du mois d’avril.
Puis, on a beau dire, le monde, il n’est pas si terrible que ça : il y a tout autour de nous des gens qui nous aiment, qui nous font confiance, qui comptent. Tant que ceux-là ne sont pas en danger, on ne bouge pas. On conserve le bonheur en boîte, pour qu’il dure le plus longtemps possible.
Mais le bonheur, ce n’est pas un parfum rare ; c’est une plante. On ne peut pas le ranger dans un coin sombre en soi. Il faut le laisser se gorger de l’extérieur, qu’il s’endurcisse face aux rigueurs de la vie. Ce n’est que de cette façon qu’il devient suffisamment fort pour nous porter.
Nous, les enfants du net
Voici un texte qui n’est pas de moi mais qui m’a beaucoup inspiré pour la rédaction de la Lettre ouverte, quelques jours plus tôt. Un article déjà traduit en anglais, en allemand et donc désormais aussi en français grâce aux bons soins du Framablog. Une lecture qui me semble très intéressante, presque un manifeste pour ceux qui utilisent l’internet (et qui essaient de ne pas se laisser utiliser).
Piotr Czerski (translated by Marta Szreder) – 11 février 2012 – CC by-sa
(Traduction Framalang : Clochix, Goofy, Lamessen et Xavier) Lire la suite
Lettre ouverte
« La recherche de connaissance,
la circulation de la connaissance
et l’acte de copie
sont sacrés. »
Très cher ami,
Ceci est vraisemblablement mon dernier courrier avant longtemps.
Comme tu le sais, la vie a été très dure pour moi, ces temps-ci. Mais je n’ai pas été le seul à souffrir de cette situation intolérable et pourtant tolérée. Je t’avais dit que je ne me cacherais pas. Après avoir vécu ma foi au grand jour, comme beaucoup d’autres, j’ai perdu mon travail il y a quelques mois. Tu as sans doute entendu que tout poste de la fonction publique nous était désormais interdit. Mon travail de fonctionnaire est donc devenu incompatible avec mes opinions religieuses. Ils ne se rendent pas compte que les persécutions que nous subissons nous ramènent aux temps les plus obscurs de l’histoire occidentale. Lire la suite
C’est le printemps (that springs!)
Ça y est, c’est le printemps. Ça devait bien arriver un jour. C’est le printemps et, face à ce fait accompli, on peut avoir de nombreuses réactions : certains s’émerveillent, comme si c’était la première fois que ça arrivait, ce renouveau miraculeux (et c’est vrai, d’une certaine façon : le printemps que l’on vit n’est jamais le même que tous les précédents, dépendant de tellement de paramètres que celui-ci est véritablement unique), d’autres encore se sentent d’humeur primesautière et sifflent avec les oiseaux. Il y en a, ceux qui sont un brin plus désabusés, qui se moquent quelque peu des sus-mentionnés. Il y a ceux qui bossent et qui n’ont pas de temps à perdre avec ces conneries, s’il vous plaît – ce sont les mêmes qui, quand il neige, ne voient pas le manteau de nacre sur la terre mais pensent au fait qu’ils arriveront en retard au boulot. Il y aussi ceux qui savent pourquoi les abeilles meurent un peu partout. Ceux-là, ils profitent d’autant plus de ce printemps qu’ils ont peur que ce soit un des derniers que l’on ait à vivre. Lire la suite
Récit
Fin.
Ces lettres s’éternisèrent sur la paroi de l’œil et disparurent alors que le livre se refermait. À l’intérieur, on savoura. Une réflexion intense fit fonctionner l’imagination à plein régime. Mais, doucement, un scintillement remplit le fond des yeux, tandis qu’un sourire se dessinait sur le visage tranquille. Les meilleurs moments repassaient au ralenti, en gros plan, à répétition, selon son bon vouloir. Plus précis qu’un film, plus savoureux qu’un récit, la beauté de la lecture avait happé et mobilisé toute la concentration du lecteur. Il savoura longtemps sans être dérangé par le monde extérieur. Lire la suite
Lunaire Quindécan
Je lève les yeux et voilà la lune voilée. Elle m’apparaît à intervalle irrégulier. J’attends une apocalypse qui ne viendra pas. Je marche sans but, un peu ivre, un voile devant l’esprit. Je marche droit et vite. J’essaie de fuir le temps mais il me rattrape. Et ma servile cervelle se souvient. Je marche plus vite encore. Pour échapper à mes souvenirs. Et je me heurte au futur qui m’attend. Je m’arrête. Ne pas reculer, ne pas avancer. Rester là, sans bouger. Dormir. Mourir, un peu.
Les mots ne sont pas ces choses molles et informes que l’on croit. Les mots s’usent et changent. Ils vivent. Ils vivent, sans moi. La lune n’est pas que ce globe d’argent que j’ai déjà dit. J’ai murmuré tellement souvent « je t’aime » que je dois repenser la langue. Faire d’un poisson une dague. Repenser le monde. Je pense avoir fait le tour : il faut entrer dans le cercle. Parler autrement. Ne plus parler, peut-être. Se taire. Plonger dans un monde de nondits. Non, pas plonger. Glisser.
Parfois, sans que je sache pourquoi la mélancolie s’empare de moi. Comme une main noire qui serre mes pensées pour en extraire un jus amer. Toute joie déserte mon corps et je me sens seul en moi-même, comme si j’étais loin de moi. Je cherche du réconfort en dehors mais je n’en trouve pas. Je deviens quelque peu cynique, méprisant le genre humain. Puisque je ne peux plus avancer ni reculer, je me mets à creuser. Le sable du désespoir se glisse sous mes ongles, s’infiltre dans ma gorge, rendant chacune de mes paroles plus sèche. Mais enfin, je crois trouver une eau qui m’a attendu pendant des siècles. Je m’en abreuve et j’étanche ma soif, faisant de chaque goutte un nectar sans pareil. Je découvre au plus profond de ma détresse une oasis rafraîchissante. Je sais que la chaleur étouffante est toujours dedans moi, que bientôt j’aurai de nouveau soif. Mais ce petit rien suffit à me faire penser que tout n’est pas perdu. Oui, la mort et le néant rôdent partout. Mais je suis vivant et j’existe. À tout prendre, je crois qu’il vaut mieux en vivre.
Rien n’est perdu mais tout n’est pas trouvé. Il faut juste se donner la peine de chercher. La fin n’est pas une fin en soi. Il n’y a qu’un début. Il n’y a qu’une seule fin. Le reste, c’est du remplissage : être heureux. Se trouver des masques, faire des enfants, survivre à son corps, croire, penser, parler, pleurer, etsetra. C’est comme ça que l’homme fonctionne ; il est convaincu d’être l’unité de temps par excellence. Pour lui, il y a un avant et un après lui. Il est même des milliards de pendant lui. Il ne veut pas savoir qu’il n’est pas unique. Pourtant, c’est superbe d’être multiple. Il y a forcément une oreille qui correspond parfaitement aux paroles que l’on laisse vibrer. Quand je me retrouve seul dans ma tête, je me convainc que tous font le mal – et le bien aussi – par ignorance. C’est ça qui m’empêche de pleurer, et parfois me fait sourire.