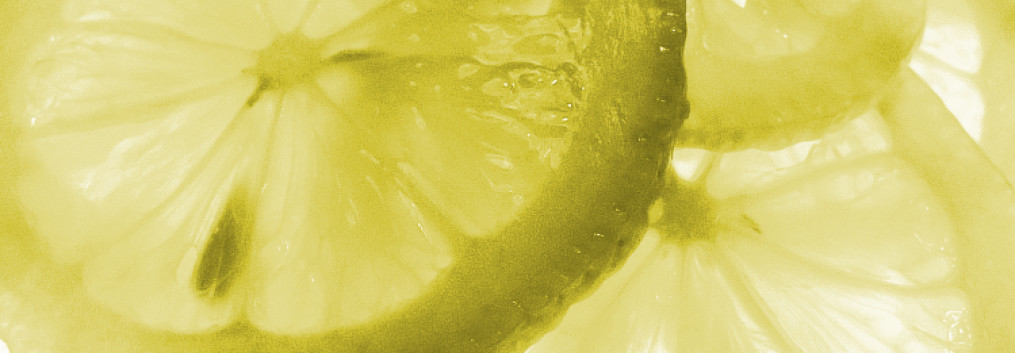Et pour répondre à Laurent, voici un texte assez ancien sans prétention qui n’a que quelques rimes pour bien prétendre au rang de poème. Lire la suite
Poésie
Qui lit encore de la poésie ? Je n’en sais rien. Mais je sais que j’en écris et que j’aime ça. Et ça m’est suffisant.
Lunaire Sextidécan
Quand on y pense, il y a de quoi pleurer.
Dans un pays que Platon aurait voulu gouverné par les philosophes rois, le peuple perd tout. Il n’aura bientôt même plus ses yeux pour pleurer. Certains n’ont déjà plus que le choix de leur mort. Les plus jeunes, ceux qui ont encore un avenir à défendre, hurlent à la vengeance. Ils sont prêts à lutter contre cette crise qu’ils n’ont pas méritée et encore moins voulue.
Et cette vague qui recouvre la Grèce lèche déjà les côtes de nos habitudes. À l’horizon de nos vies, l’avenir est plus flou encore qu’auparavant. Le monde tremble sous les coups de ces hommes que j’imagine si peu humains. Du genre à changer l’or en argent.
Même le ciel bleu n’est plus un refuge, puisqu’il cache quelque blessure faite par notre inconscience. Il pèse sur nous de toute sa légèreté. Souvent je l’ignore. Il se ternit quand j’y pense. Au loin, une couronne de pollution sacre et ceint Bruxelles. Tout le monde est touché. Ceux qui n’y sont pour rien peut-être plus que les autres.
Et puis, il y a partout des amis qui se déchirent, des amants qui se défont, des êtres qui s’en vont.
Pour ne pas y penser, il y a de quoi se leurrer.
Il y a cent moyens de se saouler. Pas besoin de tous les citer. Les moyens varient selon les envies. Chacun dispose de ses propres ivresses qui permettent d’oublier le quotidien sordide. S’enivrer permet de garder la tête hors de l’eau, de surnager, de survivre. Au final, il ne s’agit que de prendre suffisamment de distance avec le monde ; éviter de se faire absorber.
Les rares sobres découvrent la réalité dans tout ce qu’elle a d’absurde. Ils entrevoient la voie sur laquelle nous sommes engagés. Face à une telle révélation, il faut s’accrocher. On peut alors décider de s’en foutre ou de faire changer les choses. Quoi qu’il en soit, quand on décide d’une attitude face au monde, il vaut mieux ne pas vaciller. Le monde, c’est une force assez effroyable. Il faut avoir ou les deux pieds sur terre ou aucun, sinon on bascule et on se retrouve les autres fers en l’air.
Et malgré tout cela (et grâce à tout cela), on est heureux.
On ne fait pas exprès. C’est juste qu’on en a l’habitude. Parce que ça pourrait être pire et que ça ne l’est pas. Qu’après tout, la misère, elle est loin. Que si même la nuit il fait si clair, c’est que tout n’est pas si sombre qu’on le pense. La nouvelle lune est loin des esprits quand l’astre se montre en entier dans le ciel nuageux du mois d’avril.
Puis, on a beau dire, le monde, il n’est pas si terrible que ça : il y a tout autour de nous des gens qui nous aiment, qui nous font confiance, qui comptent. Tant que ceux-là ne sont pas en danger, on ne bouge pas. On conserve le bonheur en boîte, pour qu’il dure le plus longtemps possible.
Mais le bonheur, ce n’est pas un parfum rare ; c’est une plante. On ne peut pas le ranger dans un coin sombre en soi. Il faut le laisser se gorger de l’extérieur, qu’il s’endurcisse face aux rigueurs de la vie. Ce n’est que de cette façon qu’il devient suffisamment fort pour nous porter.
Lunaire Quindécan
Je lève les yeux et voilà la lune voilée. Elle m’apparaît à intervalle irrégulier. J’attends une apocalypse qui ne viendra pas. Je marche sans but, un peu ivre, un voile devant l’esprit. Je marche droit et vite. J’essaie de fuir le temps mais il me rattrape. Et ma servile cervelle se souvient. Je marche plus vite encore. Pour échapper à mes souvenirs. Et je me heurte au futur qui m’attend. Je m’arrête. Ne pas reculer, ne pas avancer. Rester là, sans bouger. Dormir. Mourir, un peu.
Les mots ne sont pas ces choses molles et informes que l’on croit. Les mots s’usent et changent. Ils vivent. Ils vivent, sans moi. La lune n’est pas que ce globe d’argent que j’ai déjà dit. J’ai murmuré tellement souvent « je t’aime » que je dois repenser la langue. Faire d’un poisson une dague. Repenser le monde. Je pense avoir fait le tour : il faut entrer dans le cercle. Parler autrement. Ne plus parler, peut-être. Se taire. Plonger dans un monde de nondits. Non, pas plonger. Glisser.
Parfois, sans que je sache pourquoi la mélancolie s’empare de moi. Comme une main noire qui serre mes pensées pour en extraire un jus amer. Toute joie déserte mon corps et je me sens seul en moi-même, comme si j’étais loin de moi. Je cherche du réconfort en dehors mais je n’en trouve pas. Je deviens quelque peu cynique, méprisant le genre humain. Puisque je ne peux plus avancer ni reculer, je me mets à creuser. Le sable du désespoir se glisse sous mes ongles, s’infiltre dans ma gorge, rendant chacune de mes paroles plus sèche. Mais enfin, je crois trouver une eau qui m’a attendu pendant des siècles. Je m’en abreuve et j’étanche ma soif, faisant de chaque goutte un nectar sans pareil. Je découvre au plus profond de ma détresse une oasis rafraîchissante. Je sais que la chaleur étouffante est toujours dedans moi, que bientôt j’aurai de nouveau soif. Mais ce petit rien suffit à me faire penser que tout n’est pas perdu. Oui, la mort et le néant rôdent partout. Mais je suis vivant et j’existe. À tout prendre, je crois qu’il vaut mieux en vivre.
Rien n’est perdu mais tout n’est pas trouvé. Il faut juste se donner la peine de chercher. La fin n’est pas une fin en soi. Il n’y a qu’un début. Il n’y a qu’une seule fin. Le reste, c’est du remplissage : être heureux. Se trouver des masques, faire des enfants, survivre à son corps, croire, penser, parler, pleurer, etsetra. C’est comme ça que l’homme fonctionne ; il est convaincu d’être l’unité de temps par excellence. Pour lui, il y a un avant et un après lui. Il est même des milliards de pendant lui. Il ne veut pas savoir qu’il n’est pas unique. Pourtant, c’est superbe d’être multiple. Il y a forcément une oreille qui correspond parfaitement aux paroles que l’on laisse vibrer. Quand je me retrouve seul dans ma tête, je me convainc que tous font le mal – et le bien aussi – par ignorance. C’est ça qui m’empêche de pleurer, et parfois me fait sourire.
Lunaire Quadridécan
Il faut s’imaginer la vie non comme elle est
mais comme elle devrait être. Puis, s’attarder parfois
sur les petits moments qui passent trop souvent
inaperçus dans ce grand tout où l’on est rien.
Voilà pour la sagesse : quatre vers pas mal faits, qui sonnent presque juste, alexandrins je crois ; enfin, ça y ressemble, d’assez loin, sûrement. En tout cas, selon moi, ils sonnent vraiment bien. Comment dire ? je sais pas, j’ai envie… je voudrais juste quelques instants que je prendrais pour moi, pour respirer, ouvrir les yeux, vivre un moment. Il le faut, puisqu’on meurt quand même à la fin.
Il faut qu’on s’arrête sur la route, en forêt, et qu’on lâche un sourire, les sens tout en émoi, quand passe une bestiole, un machin pas bien grand, une souris ou je ne sais quoi qui ne sait rien des humains. Ç’a lieu dans une forêt, j’ai dit. Il y fait frais et même, en plein hiver, il peut y faire froid. Pourtant, elle, elle s’en fout : elle fouille et, en grattant, elle fait un peu de bruit, comme une petite main. Je me penche sur elle, je m’arrête et me tais ; je retiens mon souffle, je compte jusqu’à trois et le temps s’étire sous le poids des grattements. Tout contemplatif, j’en oublie mon traintrain. La tête vide, je lève les yeux, niais, et je reprends conscience des autos, du fracas horrible de la ville qui me vrille les tympans. Tout à coup, j’ai besoin d’aller dormir un brin. Quand je m’ensommeille, je découvre la paix que procure parfois la douceur de bons draps. Je ne veux plus bouger. Je veux juste, un instant, oublier que le monde est monde, que l’homme est vain. Puis, je veux m’enfoncer dans des tréfonds épais d’où je ne sortirais qu’à grand peine, malgré moi, pour vider mes tripes, pour les remplir souvent. Je sais que c’est idiot, mais je rêve au matin d’être encore endormi.
J’en ai assez, tu sais ? On est tellement nombreux sur terre que quelque fois je me dis qu’enfin, sans moi, ça changerait pas tellement les choses. Puis je me dis que je vis, que c’est pas rien. Il faudrait pas mourir. Pas tout de suite, en fait. Il faudrait avoir le temps de dire adieu, le droit, et ben, de vivre assez pour embrasser les gens qu’on aime et qu’on quitte. Alors, je vis, putain, parfois juste pour ceux qui meurent trop tôt, c’est vrai. Enfin, j’écris aussi, j’oublie tout : eux, vous, moi. J’oublie la société qui n’avance pas vraiment, qui tourne en rond et qui tourne encore, sans fin. Je m’enfonce en pensée dans une vie de projets, dans un fauteuil d’idées confortable, vrai roi de terres immenses où j’erre pauvrement, imaginant, réfléchissant, parfois en vain. Pendant quelques années, j’aimerais vivre en paix, mais pour ça, il faudrait sans doute changer les lois qui font l’homme mauvais, le rendent méchant et tellement médiocre qu’il en est malsain.
Lunaire Tridécan
Il y avait ces vents : un déchaînement d’airs. L’impression de sentir sur nos pauvres corps Des mains qui emportaient loin, très loin, nos misères. On croyait entendre résonner un grand cor Soudain accompagné par des cloches d’airain Qui tintinnabulaient dans un concert étrange. Sous un soleil voilé, midi sonnait enfin ; Ce n’était pas un temps à voir voler un ange. C’était pourtant l’hiver depuis déjà longtemps, Mais l’automne restait sur nos têtes baissées, Ne voulant pas partir, s’étirant, serpentant Et nous enveloppant dans sa toison tressée De fins nuages gris piqués de feuilles mortes. Les vents nous empêchaient d’avancer, de bouger, Sifflant, soufflant cent fois en bourrasques si fortes Qu’on marchait sur place, comme dans l’escalier Roulant d’une gare sur lequel on irait À contresens, parlant de tout. De rien surtout. Tout autour s’arrêtaient les gens, tous à l’arrêt. Ils étaient tous figés. Les vents couraient partout.
Et parfois, il pleuvait des perles minuscules De bruine sans un bruit, formant des diadèmes Posés sur les cheveux de dames noctambules Errant, marchant toujours, murmurant des « je t’aime ». Celles-ci promenaient leurs admirables croupes Tout au long de trottoirs désertés par la foule Qui quittait ces appâts pour converger en troupes Vers d’autres vitrines que léchait cette houle. Le traintrain de ces gens s’est poursuivi sans cesse : Jamais de changement, ou alors bien trop lent Ou trop insignifiant pour qu’ils oublient leurs fesses Qui monopolisent toute leur attention.
En ce début d’année, rien de neuf sous le ciel. Il y avait toujours partout sur la planète Des guerres, des crimes, des riens superficiels. Un empire d’argent et son armée de dettes, Piétinaient doucement nos dernières valeurs. Loin de nos idéaux grandissait l’avenir. Son engrais, le passé, n’était pas le meilleur. Le plant déjà malade allait de mal en pire.
Puis, un parfum dans l’air s’est emparé de nous : Parfum de terre humide et de fruits mûrs croqués, De cheveux de femmes. Il a laissé un goût De voyages sans fin en hommes défroqués. Quand la lune apparut, pleine, immense et superbe, Un grand raz-de-marée vint pour nous emporter, En charriant avec lui l’humanité en gerbes D’eaux teintées de rouge. Je me suis réveillé.
Et moi, j’avais le cul posé sur une chaise, Le nez sur des feuilles et les yeux dans le vague. Le monde m’appelait tout au long de ces treize Quatrains bancals que j’ai écrits, comme une blague.
Lunaire Dodécan
Du haut de la lune, je pose mon regard
Sur tout, éberlué par ce monde nouveau.
L’air me semble si pur, les eaux tellement claires
Depuis là-haut : c’est fou, mais tout me paraît beau.
Comment donc comprendre cet immense bazard ?
De mon satellite, moi, j’observe ces eux.
Tous, ils sont étranges. Ils déambulent toujours
D’un point à un autre. Parfois, ils désespèrent,
Arrêtent de chercher, se tournent vers le jour
Mais n’y voient rien du tout. Pourtant, ils sont heureux.
Tombé de la lune, je vadrouille au hasard :
J’hume mille parfums. Je vois bien des tableaux :
Des pays éclairés par des tas de lumières !
Le monde va, superbe, en novembre : il fait chaud.
Le soleil s’étire derrière la nuit noire
En fines draperies s’étendant dans les cieux.
Mais, petit à petit, les jours se font plus courts,
Les rayons obliquent dans l’épaisse atmosphère
Et ne réchauffent plus mon corps qui se fait lourd.
Le froid se fait mordant et fait pleurer mes yeux.
Marchant sous la lune, sur les grands boulevards,
Je vais dans la ville. J’avance sans un mot
Le long des façades aux vitres lucifères.
J’ai froid, faim et sommeil. Tout s’éteint face aux maux
Que je traîne avec moi. Dans cette vie bizarre,
Je ne reconnais rien, comprends pas les enjeux :
Ce que j’imagine prend un tout autre tour
Lorsqu’il est confronté à ces faits délétères.
Je m’enferme tout seul. En fait, je deviens sourd
Et aveugle et muet. J’oublie tout de mes vœux.
Regrettant leurs lunes, tous errent dans les bars
Dans la ville bruyante, offrant leurs idéaux
Qui se noient dans l’alcool cognant contre le verre.
Sous la lune brillante, ils tordent leurs cerveaux.
Au matin, à huit heure, ils vident sans retard
En plus de la boisson tout ce qu’ils ont en eux.
J’essaie de faire pareil et parler sans détour
Mais je réfléchis trop. Des pensées étrangères
S’emparent de ma tête et en font un labour,
Gravant d’affreux sillons. Je m’enfuis où je peux.
Les arbres résonnent de centaines de chants
Tandis qu’épuisé, je repose dans ce champ.
Et quand la grande orbe sort, disparaît du monde,
Il ne reste plus rien alors que je vous pleure :
Je quitte cette vie superbe tant qu’immonde.
Et mon corps trop maigre refroidit, becqueté
Sans un bruit, sans un son dans la nuit. Je me meurs
Sous la lune pleine comme un soleil glacé.
Lunaire Undécan
Ce monde autour de lui seul il se l’est construit
Il marche dans ses rues et dans ses avenues
Il se retrouve enfin sur des petits chemins
Il s’amuse parfois à penser tout détruire
Les tréfonds cérébraux sont colline et vallée
Qu’il aime à découvrir et à escalader
Une fois tout en haut il redescend à pied
Aperçoit des idées empilées en montagne
Ce soir c’est pleine lune il ne veut pas penser
Demain il fera jour et il réfléchira
Il ferme les yeux : blanc. Il les réouvre : noir.
C’est simple comme tout quand tombe du ciel l’imbre
Tout s’éclaircit en soi quand on peut y pleurer
Une chaleur nouvelle amène quelques rires
Et la vie refleurit en bouquets de soleils
Tous ces mots ce ne sont pas de la poésie
Juste quelques phrases murmurées à la brise
Qui peut-être enfleront en de grandes tempêtes
Et deviendront alors quelques morceaux de prose
Sous la lumière pâle il siffle doucement
Bientôt dans la nuit noire il ne chantera plus
Il marche, larme à droite, en passant l’arme à gauche.
Tant pis pour lui s’il meurt il a trop bien vécu
Souvent assis coincé entre des quatre murs
Et parfois prisonnier perdu dans les prairies
Tant mieux pour lui s’il vit il aime bien trop ça
Il y a des bruits dehors il ne peut pas dormir
Il se retourne encore et encore et encore
Puis il ne bouge plus immobile tranquille
Il s’endort sans un bruit oubliant le tumulte
Sous la lune un chœur vit quand l’univers inspire
Il y a son cœur qui bat l’univers qui respire
Il se sent revivre, puis encore mourir.
Il rumine tout seul prisonnier de sa cage
Balayée par des vents qui ne cessent jamais
Il ne respire plus il arrête son souffle
Les murs se lézardent puis s’écroulent sur lui
Il entend du Mozart et son doux requiem
La machine tremble pendant quelques secondes
Ne tremble plus du tout pendant bien des minutes
C’est maintenant Chopin et sa marche funèbre
Elle est à son zénith l’orbe d’argent brillant
Il serre sa poitrine et meurt d’avoir pensé
C’était le dernier homme. Il n’est pas vraiment mort.