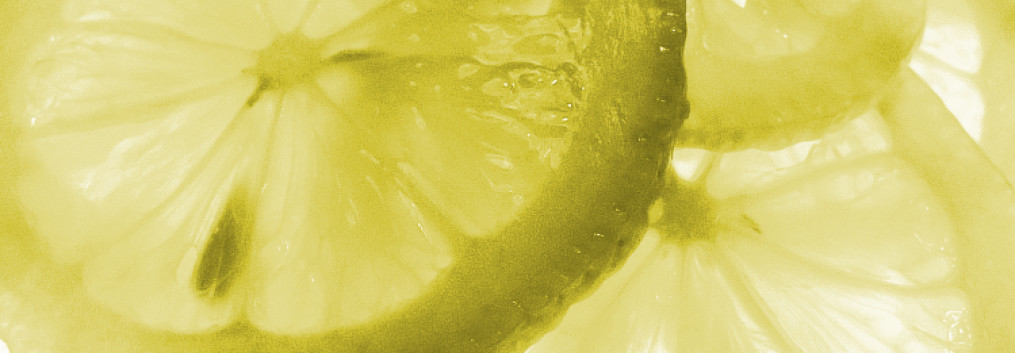Tous les jours, vers dix heure du matin, je passe le long du Parc du Cinquantenaire pour aller travailler. À cette heure-ci de la journée, il n’y a pas grand monde dans l’avenue de l’Yser. Les travailleurs se sont enfermés dans leurs cages de verre. Les enfants sont tous des élèves, les fesses soudées à leurs bancs d’école. Les températures du mois de janvier, quoique douces pour la saison, découragent les promeneurs. Quand je sors de la station Mérode pour prendre le chemin du boulot, j’évite le concert des klaxons et les mines tristes à mourir de mes concitoyens. Leurs cernes et leurs gueules qui traînent jusque par terre me donnent toujours envie de leur hurler dessus. Heureusement, à mon heure habituelle, pas de pollution visuelle ou sonore. Rien d’autre que le bonheur de marcher le long du parc bordé d’arbres en profitant de la tranquillité hivernale.
Ce matin, au croisement des avenues de l’Yser, de la Chevalerie et de la Renaissance, au moment où j’allais m’engager dans cette dernière, un détail m’arrête. C’est à l’emplacement de ce qui aurait pu être un rond-point, mais de ce qui est plutôt une de ces bizarreries conçue par un ingénieur en manque de temps. Il s’agit de deux triangles coupés par l’avenue de la chevalerie et contournés par celle de l’Yser d’une part et par celle de la Renaissance d’autre part. Ces accotements me donnent toujours l’impression qu’il y avait là un vide qui a dû être insupportable pour l’ingénieur et qu’il l’a rempli comme il pouvait. Et pour faire joli, il y a fait planter des arbres (des marronniers).
Ces arbres sont d’ailleurs la raison de mon arrêt inopiné. L’un d’entre eux, le plus proche de moi lorsque je sors de l’avenue de l’Yser et le plus grand des cinq arbres, a tout bonnement disparu ce matin. Pourtant, hier encore il se dressait à la pointe de son triangle, projetant son ombre sur le jeune marronnier à côté de lui. Là, il n’y avait plus rien. Même pas de terre fraîchement retournée. Même pas de souche coupée à ras. Même pas le souvenir d’une branche au sol.
Je reste là pendant un long moment, sans trop savoir pourquoi. L’absence de cet arbre qui a été là si souvent lors de mes allers-retours journaliers me cause un trouble indescriptible. Comme une étoile dans la nuit qui s’éteindrait soudainement. Ce sont les cloches de l’église Saint-Dominique qui me sortent de ma stupidité. Je me rends compte que je suis déjà en retard et qu’il faut que je me dépêche. Je reprends mon chemin en lançant des regards par-dessus mon épaule au vide laissé par mon arbre.
Je rentre tard le soir par le même chemin. On n’a jamais rien sans rien. En commençant tard, je finis immanquablement tard aussi. Parfois, il m’arrive de rater le dernier métro pour rentrer à la maison. Aujourd’hui, j’ai encore un peu de temps avant que cette situation inconfortable soit d’actualité. J’ai presque oublié la disparition du marronnier. En tout cas, j’ai passé la matinée à me persuader que j’étais peut-être passé la veille sans voir qu’il avait été abattu. Et ce matin, j’ai dû arriver après que les ouvriers communaux avaient rebouché le trou laissé par l’arbre, en attendant d’en replanter un nouveau.
Lorsque j’atteins au carrefour, je le traverse sans m’arrêter. Ça doit être la saison et le manque de soleil qui me rendent un peu trop sensible. Tout repère est important dans ce genre circonstance. De retour dans l’avenue de l’Yser, je passe le long des maisons le regard au sol, perdu dans mes pensées. Soudain, je m’arrête. Je viens de passer à côté d’un endroit où il y aurait dû y avoir deux arbres l’un à la suite de l’autre. Ils n’y sont plus. Je ne me suis pas encore retourné pour le vérifier, mais je le sais. Ils ont eux aussi disparu. J’ai peur de constater ce fait absurde et peut-être même de voir qu’il n’y a là aussi aucune trace de terre remuée récemment ou quelque autre indice de leur présence passée.
Pour retarder ce moment où je vais faire volte-face, je tourne ma tête à droite, pour accrocher mes yeux aux branches des arbres du Parc du Cinquantenaire. Loin de me rassurer, cette contemplation me perturbe encore plus, puisque je crois déceler l’absence de quelques silhouettes au milieu de la masse de bois tendue vers les cieux. Je suis à ce point perdu dans mon hébétude que j’en rate le dernier métro. Dans le taxi qui me ramène chez moi, j’essaie de me convaincre qu’il doit y avoir une explication rationnelle à ces disparitions. Malgré tout, mon trouble ne disparaît pas tout à fait.