Il y a des signes qui ne trompent pas. Les jours raccourcissent. Les feuilles tombent aux arbres. Les corps se couvrent de couches innombrables de vêtements et imaginent mille autres choses pour se réchauffer. Les peaux disparaissent à la vue et l’on n’aperçoit plus qu’à peine une paire d’yeux coincée entre le bord d’un bonnet et les plis d’une écharpe. Les paroles s’échappent en nuages évanescents.
Le froid belge est particulier. En plus de tout ce que j’ai pu ressentir lors de quelques voyages, il y a ce vent que notre paysage sinueux freine si peu. Il rend les choses plus acérées et donne une saveur particulière à l’air que l’on respire. Les larmes en viennent aux yeux. Et il y a aussi cette humidité qui s’infiltre jusqu’aux os en gorgeant les cœurs. Il y a des épices rares qui appellent au voyage. Et pour ceux qui ne peuvent pas partir, il reste toujours les plaisirs que procurent un lit recouvert de couches épaisses de tissus. Et pour ceux qui ont le malheur de se lever tôt, il ne reste plus qu’à attendre le printemps qu’ils vivront alors comme une délivrance.
Moi, tout au long de ces jours ennuyés, je me laisse parcourir par des maux doux.
Ce ne sont pas les péchés capitaux, non. Ce ne sont pas des vices meurtriers. Je ne risque pas grand chose à les laisser grandir en moi. Ce ne sont pas des fauves comme la Luxure ou la Gourmandise. Elles ne tueront pas comme l’Envie, l’Avarice, l’Orgueil ou la Colère. Elles sont les rejetons presqu’inoffensifs de la Paresse. Ce sont de petites bêtes inoffensives. Elles ne sont pas bien méchantes et, même, elles m’enchantent. Je les nourris bien volontiers d’idées inachevées, de brouillons de pensée. En retour, elles me tiennent chaud durant ces froides soirées où l’automne installe ce tapis rouge et d’or sur lequel l’hiver triomphant marchera d’ici peu. Elles m’immobilisent. Je me fige dans le temps et l’espace. Je me fais leur hôte et les nourris de quelques soupirs le soir, d’une poignée de respirations de plus le matin, d’un bâillement l’après-midi.
Quand je somnole, elles sont là. Quand je m’ennuie, elles sont là. Quand je me renferme, elles ont la main sur la poignée de porte. Elles m’observent toujours avec un sourire léger comme un battement de cils.
Elles, ce sont la langueur, la distraction et la nonchalance.
Langueur me fait regretter les temps passés, surtout ceux que je n’ai pas connus et dont le temps a effacé tous les défauts, si bien qu’ils me semblent purs. Le passage du temps laisse une patine qui rend beaux même les événements les plus laids. Elle s’allie parfois à la mélancolie sans en prendre les défauts. Ce qu’elle me fait voir n’est pas le passé mais une sorte d’image fantasmée et magique. Elle anesthésie le jugement plus efficacement encore que la télévision. Elle me met dans un état d’esprit qu’on pourrait penser mystique. Pourtant, elle ne fait qu’occulter une partie de mon jugement pour que la réalité m’apparaisse simplifiée.
Distraction estompe les temps présents. Il dresse une barrière entre moi et le monde extérieur. Le court terme se fond en un néant improbable auquel je cesse de songer. Elle préfère concentrer mon attention sur les détails inutiles qui font la vie. Elle annihile tout stress. Elle dissous les légères peurs du quotidien. C’est comme si je me retrouvais déconnecté du monde. Cette petite déesse, ma préférée, me plonge dans un oubli délectable. C’est le réveil qui fait mal.
Nonchalance me cache les temps futurs. Elle retire de l’attente un suc envoûtant, flatte doucement mon égo, engourdit mes sens et me met des œillères à l’âme. Elle m’est la plus dangereuse car elle sait comment me flatter et comment me faire perdre le sens des réalités. Elle sait aussi utiliser mes faiblesses pour que j’en vienne à oublier volontairement le monde. Elle a compris que j’essaie d’avoir prise sur ce monde et que je n’y arrive pas. Alors, dans les moments de solitude où j’en viens à me parler à moi-même, elle détourne mon attention et plonge mon esprit dans la fiction, me gorgeant d’irréalités. La chose est d’autant plus facile que mon quotidien se fait parfois répétitif. Ma conscience en devient alors fragile. Je m’enfonce dans la tiédeur de mes pensées. En apnée. Je finis toujours par remonter. Toujours la surface m’appelle. Jusqu’au jour où elle gagnera.
Ces trois maux m’entravent. Ensemble, elles m’empêchent tout mouvement. Mais je prends mon mal en patience. C’est le froid qui les renforce. C’est dans l’obscurité qu’elles aiment grandir. Je sais qu’elles disparaîtront avec le retour du soleil. Les cultiver plus longtemps qu’un simple hiver, ce serait prendre trop de risques pour ce qu’elles apportent. Je sais que certains aimeraient vivre avec de pareilles amantes des années durant. Le flou dont elles englobent tout est tellement délicieux que j’aimerais y goûter indéfiniment. Ce n’est pas possible. Ce serait par trop malsain.
J’imagine une bulle où le temps s’écoulerait plus lentement. Tout serait bien au-dedans. On aurait le temps de faire des milliers de choses. On pourrait passer plus de temps à penser, à oublier les petits tracas. On pourrait repousser les échéances, ces insectes qui prennent un malin plaisir à me tarauder. Je pourrais tout oublier sauf l’essentiel. Je serais libre de penser pleinement à des sujets qui me préoccupent mais auxquels je ne puis pas m’attarder. Mais comme rien ne dure en ce bas-monde, la bulle dans lequel j’imagine pouvoir m’enfermer éclaterait un jour ou l’autre. À cet instant, le temps qui aurait été mis à l’écart se ruerait dans l’espace laissé si longtemps inoccupé comme un torrent inarrêtable. Il emporterait tout. Il reprendrait son dû. Ce n’est pas la gravité, la plus terrible des forces. De la gravité, on peut se jouer. Certains s’en affranchissent. Mais le temps.
Oh ! Il s’écoule lentement. Il glisse sur nous tous. Et parfois, durant ces soirées d’hiver si dures, je le laisse passer dans mon indifférence. Je m’immobilise un instant. Je le laisse passer. Je sais qu’il me rattrapera. Je le laisse passer. Et je m’en fous.
Tout avance. L’immobilité n’existe pas. Tout est changement. Je l’ai déjà dit : je ne crois pas au changement. Je n’y crois pas comme je ne crois pas à l’oxygène. Je n’y crois pas comme je crois à la vie. Parce qu’il n’y a pas besoin d’y croire pour que cela existe. La foi n’a rien à voir dans ce processus sans âge. Depuis le début, tout change. Jusqu’à la fin, tout changera. Le changement, c’est toujours maintenant. Les choses changent d’un instant à l’autre. Je ferme les yeux et tout a changé lorsque je les ouvre. Rien n’est plus pareil, l’univers entier a changé. Il faut être aveugle pour ne pas le remarquer. Il faut être insensible pour ne pas s’en rendre compte. Ou alors, c’est juste qu’on est trop habitué pour rien remarquer. Le vrai changement n’a pas besoin de moi pour s’accomplir. Il se fait indifféremment de mon existence. Et pourtant, dans ce gigantesque fleuve le caillou que je suis fait changer le courant. Imperceptiblement. Personne ne remarque rien, pas même moi, et pourtant je participe de ce changement éternel.
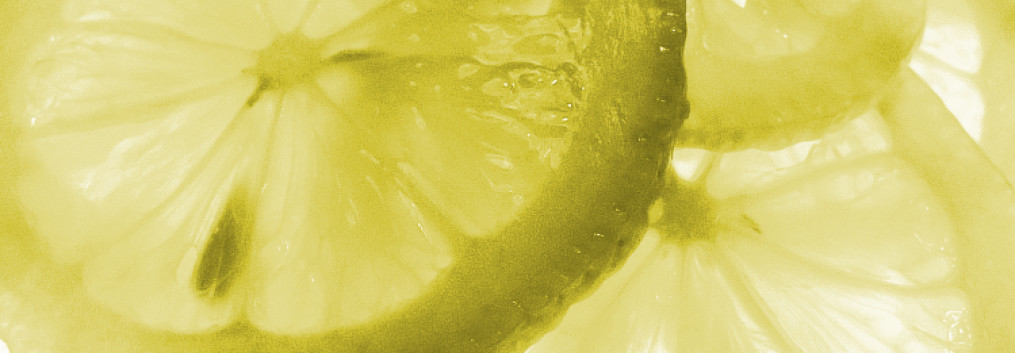
très agréable lecture où l’on partage les sensations et le climat 😉 vraiment très bien écrit et décrit ! un vrai plaisir de lire !! un petite pointe d’envie mais petite hein !!! : comme je voudrais avoir votre lâcher-prise !!!!
Ce n’est pas toujours une bonne chose : à force de lâcher prise, on perd le lien qui mène aux réalités.
Parfois, c’est particulièrement dur de garder le sens de ces réalités, d’ailleurs.
Merci pour la lecture et pour ce commentaire 😉