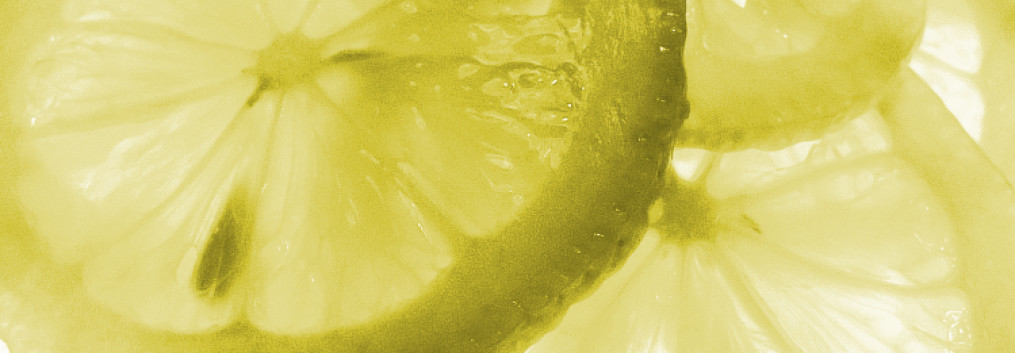La lune m’apparaît plus grosse que jamais. Elle est gigantesque et titanesque, énorme et difforme, posée sur l’horizon, écrasant tout le paysage sous elle, étirant même la réalité. Je ferme les yeux. À mesure qu’elle monte dans le ciel, je sens son poids sur mes épaules. Elle pèse lourd dans l’atmosphère saturée d’histoires que je crois vivre. Ce chant que j’entends, n’est-ce bien que le vent dans les branches ? C’est que j’en viendrais à douter de tout lorsque l’astre fait ployer jusqu’au temps qui s’étire en volutes invisibles. Je marche sans plus reconnaître le décor qui m’entoure et m’enserre. Cette sensation d’étouffement qui ne me quitte plus se fait plus présente, plus pressante même. La ville dort et pourtant les lumières restent allumées, formant une incroyable veilleuse pour le poupon urbain. Si l’on observe les carcasses de béton, on pourrait presque le voir respirer. Je remarque que le peu d’étoiles que je pouvais voir à travers les rets de lumière se dérobe devant la puissance des rayons lunaires. Ces jours-ci, le vent s’est calmé. Je m’arrête. J’ai l’impression qu’il n’y a plus qu’elle, en haut, et moi, en bas. Je lui parle mais elle ne me répond pas. Elle me traite avec le même mépris dont je me drape parfois mais qui ne me réchauffe jamais. J’ai l’impression que mes paroles se perdent dans la nuit. Elle se tait. J’ouvre la bouche : « Plus rien ? » Ces deux mots résonnent dans la pâle clarté de la minuit. Je ne suis déjà plus sûr qu’il s’agissait bien d’une question. Ma mémoire se désagrège. Les mots se réverbèrent. Ils accrochent les nuages et fondent en étincelles. Ils éclairent mes pas dans un tonnerre silencieux. Dessus ma tête, les nuages sont figés et je m’étonne de si lents cieux.
Mais voilà que je me réveille sans me souvenir m’être endormi. Je perçois la lumière du jour par deux fentes, à travers le masque que je porte de mon lever à mon coucher. Entre le manger, le boire, le vêtir, le laver, le travailler, le dormir, je me perds dans un dédale d’infinitives. J’ai l’impression parfois de rejouer les mêmes scènes, à l’infini. J’inachève et je laisse en plan. Ainsi, je suis toujours assuré d’avoir une occupation. Cette façon souvent que j’ai de ne pas mettre des mots sur mes sensations à dessein me paraît purement romantique. Le romantisme. L’inaccomplissement érigé en œuvre achevée. Voilà pourquoi on l’associe à l’amour, cette fuite en avant et à deux. En littérature, on pense que ce serait la création qu’on achèverait en écrivant le mot « fin ». J’en viens parfois à croire en la perfection de ce qui n’est pas fini. La vie n’est pas pas infinie, d’ailleurs ? C’est une idée idiote, mais se pourrait-il que l’infini ne soit atteint qu’en ne finissant pas ? J’arrête mon babillage verbeux et verbiageux pour décoller la merde de mes yeux. Crasseux, je redécouvre le monde, comme chaque matin, au filtre des actualités, des hommes assassinés et des idées mortes au soleil de la réalité. Je ne suis pas le seul à porter un masque, comme je le remarque. Mais là où le mien laisse voir un inoffensif intellectuel idéaliste, ceux des autres montrent des visages affables et honnêtes dans les télévisions. Ils sont dangereux. Puis, je me réveille tout à fait et j’oublie mes propres avertissements. Qu’ai-je à en foutre, de ces zigues zaguant entre leurs sales mensonges ? Ils s’empêtrent mais entraînent bien d’autres abrutis dans leur lente dégringolade. Que faire, dès lors ? Je ne me sens pas assez éveillé pour réagir.