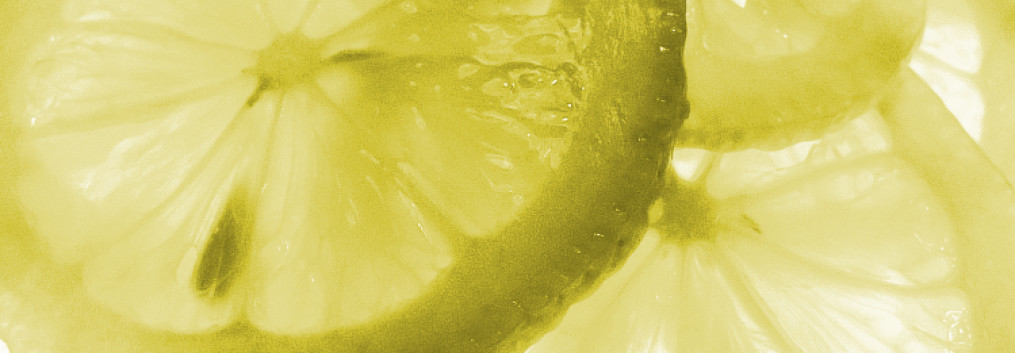La bille bleue et blanche dans le ciel a disparu. Il n’y a plus que le soleil. Le soleil et moi. Le soleil, le silence et moi. Et moi, je suis perdu dans le silence, ébloui par le soleil. Je ne bouge plus. Je reste immobile. Je ne fais qu’écouter. Sans but. Écouter le silence de mes pensées. Leur morsure est plus froide que celle du soleil. Leur venin mortel comme la vie. Ma tête résonne de ce fracas intérieur, perdu dans le silence. Déjà, il n’y a plus que moi. Je suis seul dans l’univers. La lumière du soleil tombe droit sur moi. Elle vibre un peu, dans le silence. Et moi, je pourrais presque la toucher, comme je me suis déjà saisi du silence. Il glisse entre mes doigts. Je le laisse tomber à terre et ruisseler. Il cascade doucement et remplit les mers fossiles. Il se gonfle au soleil et m’enveloppe tout entier. Je me couche à terre et je le laisse me recouvrir. Je connais cette douce brûlure du sommeil. Il ne vient jamais me chercher, ne fait que me tourner autour. Pourtant, j’aimerais l’inviter : « Viens donc, toi qui tiens dans le creux de ta main tous les hommes, qu’ils soient riches ou pauvres, faibles ou forts, vieux ou jeunes. » mais je sais qu’il ne m’écouterait pas. Il sera celui qui régnera lorsque tout aura disparu. C’est un prince orgueilleux et patient.
Je m’arrache de son emprise, je quitte son empire. Je dois m’éloigner du silence. Je dois m’exiler loin du soleil. Je dois retrouver mon identité qui se trouve au-delà de tout ce que je connais. Disparaître dans les tréfonds de mes pensées. Devenir immobile comme les roches qui forment le paysage. Ne plus bouger. Se plonger dans un perpétuel présent. Ne plus vivre ni mourir. Juste exister. Je sais que cela m’est encore impossible. Alors, je rampe jusqu’à la pénombre. Je m’enfonce dans l’obscurité salvatrice. Je rejoins l’autre face, celle où plus rien ne me touche. Seule existe encore l’immensité de l’espace. Couché au sol, je la contemple sans ciller. Le monde vacille. Je suis le seul à encore exister, dans le vacarme de mes pensées. Je me noie dans des réflexions ininterrompues. C’est ici que se trouvent ces mers qui se rejoignent mais ne se mélangent pas.
Lunaire
Un poème à chaque pleine lune, voilà le défi que je m’étais imposé pendant près de deux ans. Les vers doivent être retouchés, mais cela n’enlève rien au plaisir que j’ai eu à les écrire.
Lunaire Unviginte
D’abord la fatigue du corps. Les jambes lourdes. Les chevilles douloureuses. Les articulations craquent. Tout ralentit. Le souffle est court. Le cœur bat à peine. Les bras bougent peu. Les mains traînent. La bouche s’entrouvre. La mâchoire pend. Les paupières tombent. Chaque mouvement pèse. Le temps passe. Petit à petit. Seconde à seconde. Il s’étire. N’en finit plus. Il s’effondre sur lui-même. Le corps aussi, inerte. Une mécanique qui s’éteint. Le corps engourdi de sommeil.
Ensuite la fatigue de l’esprit. Des éternités plus tard. La carcasse désarticulée se raccroche à un fil. Celui de la pensée. Tout tient à ce fil. Autour, ce sont des brumes. Impalpables. Invisibles. Étouffantes. Le cerveau rend les armes. Les yeux voient trouble. La bouche balbutie. Les gestes se saccadent. Des ombres dansent. On se sent brillant. On ne l’est pas. On entend les pensées. À cause du silence. Ce silence absurde. La tête devient cathédrale. Chaque son est un fracas. Chaque lumière éblouit. Chaque idée est précieuse. Tout fait écho. On vit tout deux fois. On savoure l’instant. On ne le savoure plus. Il n’y a plus d’énergie pour. On savoure de ne plus savourer. On tient dans cet état. Parce qu’on sait qu’il doit finir.
Enfin tout s’arrête. Tout bascule. La tête se pose. Le corps se réchauffe. La chaleur vient du ventre. Elle se répand partout. Doucement. On sombre. Dans un sommeil sans rêve. Sans fin. La délivrance. Tout s’arrête. Tout s’éteint. Plus rien ne trouble le silence.
On attend de renaître sous une lune bleue.
Lunaire Viginte
La tête dans le ciel, le regard dans les étoiles. La toile de fond est percée de points de lumière. La fascination est grande face à cet infini. Un infini qui se trouve à portée d’yeux. Même un dieu se sentirait peu de chose devant ce très lent ballet stellaire. Alors un homme, sur Terre …
Dans cette immensité, il y a pourtant quelques étoiles qui sont des compagnons. Elles guident les nuits d’insomnie et de contemplation. Elles ne demandent rien d’autre que d’être regardées. En échange, elles offrent un certain réconfort. Un apaisement quasi mystique s’empare de l’homme sidéré. Comme un enfant découvrant un trésor.
Des milliards d’années de silence attendent qu’on les sollicite. Avec une patience toute cosmique, elles cherchent un regard à remplir. Elles fondent alors sur l’imprudent qui les a croisé. Leur silence est une force. S’il existe un peu de son sur Terre, il n’est que perdu dans le fracas muet de l’univers.
Je me sais petit. Et ça me rassure de savoir que dans cet azur assombri, il existe des milliers de corps plus grands que le mien. L’humilité s’impose à moi comme une évidence. Comment se sentir du pouvoir lorsqu’on se rend compte que l’on est rien ? Devant l’anneau galactique, je me sens apaisé. La chaleur du jour laisse la place à une douce fraîcheur. L’estomac digère le repas du soir. La tête en savoure le repos. On se prendrait presque à croire que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes.
Rien ne bouge.
Ce soir, pourtant, ce calme est rompu fréquemment. La scrutation scrupuleuse de la voûte est récompensée. De temps en temps, une roche vient s’enflammer pour retomber en fine poussière sur la Terre. Comme chant du cygne, c’est une ligne qu’elle trace dans l’espace. Le bref embrasement ravit la vision. Un battement de paupière et tout a disparu. Seul, impossible de savoir s’il s’agissait d’un rêve de quelques secondes ou de la réalité.
Quand une passe, je ne fais aucun vœu. Je me réjouis seulement d’être ici à cet instant, savourant le spectacle. Épuré de toute superstition, elles deviennent superbes. Plus besoin de parler. J’oublie que le monde existe. Il n’existe plus qu’elles. Elles sont seules, les fugaces.
Lunaire Nonidécan
– Tu aurais dû les voir ! Une véritable assemblée brueghelienne. Impossible de savoir si ces gens dansaient ou titubaient en suivant le rythme de cette musique faite de pulsations. Dans ces soirées, vois-tu, le son participe de l’ivresse. Le sol collait sous les semelles. On reconnaissait des odeurs de sueur et de bière. La chaleur étouffante amplifiaient les fragrances tenaces. De toute évidence, on ne pouvait supporter ce spectacle qu’en étant soi-même plus ou moins imbibé. Ils étaient presque aussi rond que toi, en fait.
« Je sais que tu ne comprends pas cette envie qu’ils ont de perdre conscience. Je ne suis pas sûr qu’eux-mêmes comprennent. Pour vaincre l’ennui. Pour arrêter de penser, un instant. Pour ne plus se sentir toucher terre. Pour prendre des vacances. À vrai dire, beaucoup n’ont pas besoin de raison. Ils s’enivrent d’alcool pour s’enivrer.
« Tout ce que je sais, c’est qu’ils ne se limitent pas à l’alcool, pour se déconnecter de la réalité. Le moins cher, ça reste la télé. Regarder fixement une lumière en face, ça vous abrutit suffisamment pour se croire sincèrement heureux, même lorsqu’on se trouve dans la misère la plus crasse. En fait, toutes les fictions – sur papier ou sur écran, ça n’a pas d’importance – servent à dresser un écran entre soi-même et les soucis de la vie quotidienne. Les drogues dures, c’est pareil mais en plus cher. Puis, pour ceux qui en ont besoin, on passe aux drogues continues, celles qui font flotter dans un nuage : tabac, cannabis, sommeil. La télévision, à petite dose, ça fonctionne encore comme ça. On n’oublie pas la réalité mais on se dit que c’est pire ailleurs (on oublie que c’est pas parce que c’est pire là-bas que c’est mieux ici) et on supporte.
« Mais tous ces gens, là, ils essaient peut-être d’oublier qu’un jour, il faudra gagner leur vie. Et pour la gagner, ils devront très probablement en gâcher une partie. Oh, ce n’est pas que j’ai à redire contre le travail. Il rend libre, après tout. Mais – comment dire – j’ai la nette impression qu’il rend surtout libre de s’enfermer. Je ne suis pas un expert de la liberté, mais j’ai tout de même l’impression que quelque chose cloche quelque part. Enfin, ça doit venir de moi, certainement. Je n’ai pas assez goûté à cette drogue pour en voir les vertus bienfaitrices. Surtout pour en oublier les désagréables effets secondaires. Faut leur dire, aux gens, qu’il faut pas toucher à cette saloperie. Faut pas travailler, dans la mesure du possible.
« Ce que je supporte le moins dans le travail, c’est le rapport de dépendance qui en est indissociable. On gagne de l’argent pour faire gagner de l’argent à d’autres. Mais cet argent ne vient pas du néant. Il vient de gens qui ont travaillé et qui l’ont gagné. On n’en sort pas. On gagne de l’argent pour le dépenser. Et le maigre surplus sert à survivre. Non, ça ne marche pas. J’ai beau tourner ça dans tous les sens, je ne comprends pas comment tout ça ne se casse pas la gueule par terre. Comment c’est possible, ce principe ? Tu peux répondre ? Non, forcément. T’en as rien à foutre, toi. Ça ne te concerne pas.
« Tu sais, pour pas perdre la boule, j’en suis venu à faire une distinction radicale entre travail et loisir. Le loisir relèverait alors plutôt de l’accomplissement de soi. La rémunération n’est que secondaire. On peut travailler gratuitement. On peut devenir extrêmement riche grâce à un simple loisir. La rentabilité doit être le plus mauvais critère imaginable pour classer une activité humaine. Du coup, j’espère bien ne jamais travailler. Juste faire ce que j’ai envie : dormir, manger, lire, écrire. Des plaisirs simples.
« Je veux arrêter de survivre. Je veux vivre. Et je ne crois pas que l’argent peut m’aider à atteindre ce but. L’argent, il a sa propre volonté. Comme un virus, il a tendance à se servir d’hôtes pour se multiplier. Et il répète toujours la même chose. Il n’est pas causant. Il fait tourner les gens en rond.
« Parfois, moi aussi, j’ai l’impression de tourner en rond.
Lunaire Octidécan
La clarté de la pleine lune n’éclate que pour quelques-uns.
Le claquement du verre sur le sol brise le silence.
Les coquelicots le long des rails courbent la tête après les pluies.
Il est tellement facile d’être amer.
On trouve plus agréable de parler de ce qui est en se souvenant de ce qu’il y a eu.
Le souffle d’une respiration peut rendre sourd.
Il arrive que parfois quelqu’un meure.
Les gens ne sont jamais contents du temps qu’il fait dehors.
Quand il fait chaud, même le vol d’une mouche rafraîchit.
Une corneille blessée est un oiseau qu’on évite.
Il n’y a que pieds nus qu’on se sent vivant.
Le spectacle de gouttes qui tombent sur un trottoir hypnotise.
Le son du métal sur la pierre réveille des souvenirs millénaires.
La vie, ce n’est que des cartons qui prennent la poussière.
Pendant un instant, on se croit des dieux.
Même la nuit, on peut être ébloui.
Les hommes ne dorment jamais.
L’impatience ne touche que ceux qui attendent.
Les hommes modernes regardent des lumières en face à longueur de journée.
Les bateaux sont faits pour atteindre l’horizon.
La fin compte plus que le début.
Lunaire Septendécan
La lune m’apparaît plus grosse que jamais. Elle est gigantesque et titanesque, énorme et difforme, posée sur l’horizon, écrasant tout le paysage sous elle, étirant même la réalité. Je ferme les yeux. À mesure qu’elle monte dans le ciel, je sens son poids sur mes épaules. Elle pèse lourd dans l’atmosphère saturée d’histoires que je crois vivre. Ce chant que j’entends, n’est-ce bien que le vent dans les branches ? C’est que j’en viendrais à douter de tout lorsque l’astre fait ployer jusqu’au temps qui s’étire en volutes invisibles. Je marche sans plus reconnaître le décor qui m’entoure et m’enserre. Cette sensation d’étouffement qui ne me quitte plus se fait plus présente, plus pressante même. La ville dort et pourtant les lumières restent allumées, formant une incroyable veilleuse pour le poupon urbain. Si l’on observe les carcasses de béton, on pourrait presque le voir respirer. Je remarque que le peu d’étoiles que je pouvais voir à travers les rets de lumière se dérobe devant la puissance des rayons lunaires. Ces jours-ci, le vent s’est calmé. Je m’arrête. J’ai l’impression qu’il n’y a plus qu’elle, en haut, et moi, en bas. Je lui parle mais elle ne me répond pas. Elle me traite avec le même mépris dont je me drape parfois mais qui ne me réchauffe jamais. J’ai l’impression que mes paroles se perdent dans la nuit. Elle se tait. J’ouvre la bouche : « Plus rien ? » Ces deux mots résonnent dans la pâle clarté de la minuit. Je ne suis déjà plus sûr qu’il s’agissait bien d’une question. Ma mémoire se désagrège. Les mots se réverbèrent. Ils accrochent les nuages et fondent en étincelles. Ils éclairent mes pas dans un tonnerre silencieux. Dessus ma tête, les nuages sont figés et je m’étonne de si lents cieux.
Mais voilà que je me réveille sans me souvenir m’être endormi. Je perçois la lumière du jour par deux fentes, à travers le masque que je porte de mon lever à mon coucher. Entre le manger, le boire, le vêtir, le laver, le travailler, le dormir, je me perds dans un dédale d’infinitives. J’ai l’impression parfois de rejouer les mêmes scènes, à l’infini. J’inachève et je laisse en plan. Ainsi, je suis toujours assuré d’avoir une occupation. Cette façon souvent que j’ai de ne pas mettre des mots sur mes sensations à dessein me paraît purement romantique. Le romantisme. L’inaccomplissement érigé en œuvre achevée. Voilà pourquoi on l’associe à l’amour, cette fuite en avant et à deux. En littérature, on pense que ce serait la création qu’on achèverait en écrivant le mot « fin ». J’en viens parfois à croire en la perfection de ce qui n’est pas fini. La vie n’est pas pas infinie, d’ailleurs ? C’est une idée idiote, mais se pourrait-il que l’infini ne soit atteint qu’en ne finissant pas ? J’arrête mon babillage verbeux et verbiageux pour décoller la merde de mes yeux. Crasseux, je redécouvre le monde, comme chaque matin, au filtre des actualités, des hommes assassinés et des idées mortes au soleil de la réalité. Je ne suis pas le seul à porter un masque, comme je le remarque. Mais là où le mien laisse voir un inoffensif intellectuel idéaliste, ceux des autres montrent des visages affables et honnêtes dans les télévisions. Ils sont dangereux. Puis, je me réveille tout à fait et j’oublie mes propres avertissements. Qu’ai-je à en foutre, de ces zigues zaguant entre leurs sales mensonges ? Ils s’empêtrent mais entraînent bien d’autres abrutis dans leur lente dégringolade. Que faire, dès lors ? Je ne me sens pas assez éveillé pour réagir.
Lunaire Sextidécan
Quand on y pense, il y a de quoi pleurer.
Dans un pays que Platon aurait voulu gouverné par les philosophes rois, le peuple perd tout. Il n’aura bientôt même plus ses yeux pour pleurer. Certains n’ont déjà plus que le choix de leur mort. Les plus jeunes, ceux qui ont encore un avenir à défendre, hurlent à la vengeance. Ils sont prêts à lutter contre cette crise qu’ils n’ont pas méritée et encore moins voulue.
Et cette vague qui recouvre la Grèce lèche déjà les côtes de nos habitudes. À l’horizon de nos vies, l’avenir est plus flou encore qu’auparavant. Le monde tremble sous les coups de ces hommes que j’imagine si peu humains. Du genre à changer l’or en argent.
Même le ciel bleu n’est plus un refuge, puisqu’il cache quelque blessure faite par notre inconscience. Il pèse sur nous de toute sa légèreté. Souvent je l’ignore. Il se ternit quand j’y pense. Au loin, une couronne de pollution sacre et ceint Bruxelles. Tout le monde est touché. Ceux qui n’y sont pour rien peut-être plus que les autres.
Et puis, il y a partout des amis qui se déchirent, des amants qui se défont, des êtres qui s’en vont.
Pour ne pas y penser, il y a de quoi se leurrer.
Il y a cent moyens de se saouler. Pas besoin de tous les citer. Les moyens varient selon les envies. Chacun dispose de ses propres ivresses qui permettent d’oublier le quotidien sordide. S’enivrer permet de garder la tête hors de l’eau, de surnager, de survivre. Au final, il ne s’agit que de prendre suffisamment de distance avec le monde ; éviter de se faire absorber.
Les rares sobres découvrent la réalité dans tout ce qu’elle a d’absurde. Ils entrevoient la voie sur laquelle nous sommes engagés. Face à une telle révélation, il faut s’accrocher. On peut alors décider de s’en foutre ou de faire changer les choses. Quoi qu’il en soit, quand on décide d’une attitude face au monde, il vaut mieux ne pas vaciller. Le monde, c’est une force assez effroyable. Il faut avoir ou les deux pieds sur terre ou aucun, sinon on bascule et on se retrouve les autres fers en l’air.
Et malgré tout cela (et grâce à tout cela), on est heureux.
On ne fait pas exprès. C’est juste qu’on en a l’habitude. Parce que ça pourrait être pire et que ça ne l’est pas. Qu’après tout, la misère, elle est loin. Que si même la nuit il fait si clair, c’est que tout n’est pas si sombre qu’on le pense. La nouvelle lune est loin des esprits quand l’astre se montre en entier dans le ciel nuageux du mois d’avril.
Puis, on a beau dire, le monde, il n’est pas si terrible que ça : il y a tout autour de nous des gens qui nous aiment, qui nous font confiance, qui comptent. Tant que ceux-là ne sont pas en danger, on ne bouge pas. On conserve le bonheur en boîte, pour qu’il dure le plus longtemps possible.
Mais le bonheur, ce n’est pas un parfum rare ; c’est une plante. On ne peut pas le ranger dans un coin sombre en soi. Il faut le laisser se gorger de l’extérieur, qu’il s’endurcisse face aux rigueurs de la vie. Ce n’est que de cette façon qu’il devient suffisamment fort pour nous porter.