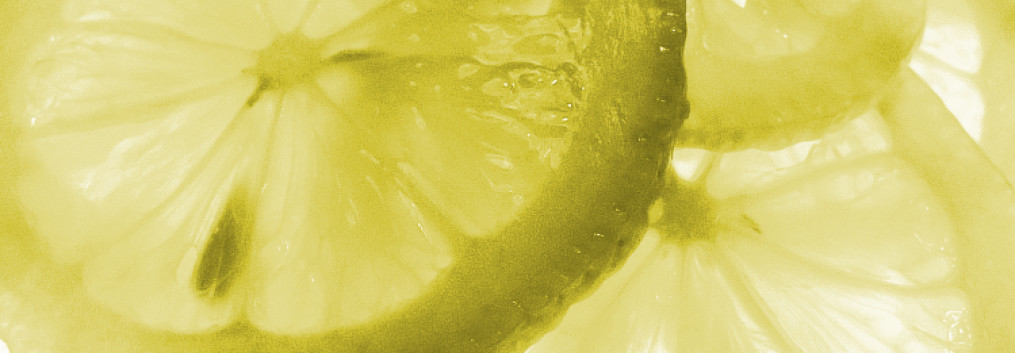Il est seize heure cinquante-trois, au carrefour du Parc de Bruxelles. À gauche, des voitures attendent. À droite, des voitures attendent. En face, des voitures attendent. Et derrière, des voitures attendent. Un peu partout, des piétons marchent en évitant les ombres froides du printemps. Des rires et des cris éclatent : le bruit de la vie.
Dans la rue des Colonies, le feu passe au vert. Il en va de même dans la rue de la Loi. Les voitures démarrent en trombe. Celles qui doivent tourner le font. Celles qui viennent de la rue de la Loi et qui doivent gagner le centre s’en vont. Celles qui viennent de la rue des Colonies rejoignent, dix mètres plus loin, la fin de la file des voitures qui n’avancent pas, arrêtées qu’elles sont trois-cents mètres plus loin, à l’autre bout du parc. Voyant que la file finit presque au milieu du carrefour, une voiture noire immatriculée au Luxembourg avance, suivie en cela par trois consoeurs. Les voilà au coeur du carrefour, alors que, derrière elles, le feu passe au rouge. Et voyant qu’il y a trois voitures qui bloquent le passage devant elles, les voitures de la rue Royale avancent, tout naturellement. Cinq mètres plus loin, elles ne peuvent bien entendu plus avancer. S’ensuit un concert de klaxons : les trois voitures vers la rue de la Loi restent immobilisées par celles qui se trouvent devant elles, empêchant les voitures de la rue Royale de rouler. Jouer des avertisseurs ne change rien mais a au moins le mérite de défouler. Les oiseaux et les enfants se taisent un instant avant de reprendre leur babil. Le conducteur de la première voiture, la luxembourgeoise, s’emporte au téléphone. La conductrice de la deuxième voiture soupire et se masse les tempes. Le dernier conducteur est aussi le propriétaire d’une ride qui lui barre le front de bout en bout. À ce moment, le feu repasse au rouge pour les voitures de la rue Royale. Dans le même temps, la file des voitures de la rue de la Loi avance de quinze mètres. Les trois voitures du milieu du carrefour font de même, libérant les deux voitures de la rue Royale qui avancent en évitant les voitures qui viennent sur leur droite et les piétons pour qui le feu est maintenant passé au vert, filant vers l’Église Royale Sainte-Marie, plus d’un kilomètre plus loin.
Cinq voitures venant de la rue des Colonies passent. Trois d’entre elles sont coupées dans leur élan au beau milieu du carrefour. Le feu passe au rouge. Dans la rue Royale, le feu libère deux voitures qui se retrouvent vite arrêtées par les trois de la rue des Colonies. Le feu passe au rouge. La file de la rue de la Loi avance un peu et libère les deux voitures de la rue Royale.
Cette histoire s’est répétée cinq fois le temps que mon tram arrive. Mon tram, le nonante-deux, se trouvait à deux-cents mètres de mon arrêt et a mis dix minutes pour arriver péniblement jusqu’à moi. Après mon départ, nul doute que cette avancée laborieuse continue de la façon dont je l’ai décrite, cent fois encore. Et les jours qui passent n’y changent rien.
Pourquoi ces travailleurs fatigués viennent-ils tous les soirs gonfler un trafic déjà dense, venant respirer plus d’hydrocarbures que n’en auraient supportés des mineurs de charbon il y a cinquante ans ? Je ne le sais pas. Peut-être s’agit-il d’un rite de communion autour d’une figure divine. Une sorte de prière pour le dieu Taylor Capitalin.
En ce jour, je me suis rendu compte que je devais être définitivement anomisque. Être anosmique, c’est ne pas avoir de sens de l’odorat. Être anomisque, ne pas avoir le sens de l’argent. La confusion est fréquente entre ces deux anomalies, puisque l’argent n’a pas d’odeur.