Ce n’est déjà plus l’automne. Ce n’est pas encore l’hiver. Les jours raccourcissent pour ne plus être que de courtes périodes de temps entre deux nuits.
Je marchais dans les rues d’Édimbourg, toutes ceintes de pierre grise. Le vent s’engouffrait en sifflant entre les murs de la cité écossaise. J’avais remonté le col de mon manteau jusques à mes oreilles pour mieux me protéger de la tourmente. Mon dos était voûté. Tout mon corps se penchait en avant, luttant de son trop maigre poids pour continuer sur sa lancée, sans savoir où il allait. Il y avait longtemps que j’avais perdu mon chemin, jugeant comme à mon habitude que c’était le plus sûr moyen de trouver une raison de s’émerveiller. « Le voyage est plus important que la destination » me remémorai-je, et « c’est bien plus beau lorsque c’est inutile ! » ou encore « les surprises n’arrivent qu’aux vivants ».
Mais étais-je alors encore vivant ? Je n’en étais plus très sûr.
Qu’importe ! Je marchais. Je marchais sans raison. Ou plutôt : je marchais sans d’autre raison que celle d’avancer. M’en fallait-il d’autre ? Après tout, mes frères humains agissaient de cette façon. Et moi-même, je n’avais pas trouvé de meilleure motivation.
Le paysage lothien défilait devant mes yeux à mesure que la nuit s’y posait doucement. Les vents se déchaînaient plus encore, mais je n’y prêtais plus attention.
Alors que face à moi se trouvait le Royal Mile, cette rue qui remonte depuis Hollyrood Palace jusqu’au château millénaire, je me rendis compte que, au lieu de monter, les pavés s’enfonçaient dans d’obscures profondeurs. C’était de là que soufflait le vent qui, maintenant, me glaçait le sang. C’était une main qui venait passer dans mes cheveux que j’avais encore épais à l’époque. Cette main me fit l’effet douloureux qu’ont les dernières paroles d’un enfant qui déjà devient adulte.
Je restai devant ce gouffre pendant d’interminables minutes.
Néanmoins, il n’y avait plus d’autre chemin. Je ne pouvais qu’avancer et enfoncer ainsi mon être dans ce que je redoutais déjà être le couloir menant à une chambre bien pire que toutes celles que l’on peut trouver sur la terre. Le parfum qui émanait de cette grotte était le parfum de l’oubli et de la fin de toute chose.
Je descendis, donc. Parce que je n’avais pas d’autre choix. Parce qu’il fallait continuer d’avancer, même si c’était pour rejoindre le pire.
La descente fut longue. Comme une seconde sans amour. Comme une nuit sans étoile. Comme une vie sans rêve. Comme une éternité sans musique.
Enfin, je finis par arriver à destination, au centre de la terre.
Je me trouvais alors loin de toute âme humaine. Ce devait être pour ça que je ressentais en moi une félicité incomparée. J’étais un autre. Un nouvel Arthur. Étranger à moi-même. Depuis l’intérieur de cette sphère à la surface de laquelle se passent tant d’absurdités, je me voyais comme en dehors de moi. Cette carcasse dont je n’étais en définitive qu’un locataire qui ne s’était toujours pas fait à la décoration continuait de s’agiter alors que je ne l’habitais plus. Mon individualité n’était plus, elle que j’avais cultivé pendant tant d’années. Voilà que j’étais deux.
Je me voyais avec des yeux neufs. Toute l’absurdité de mon être m’apparut en un instant : ces sourcils sans cesse froncés, même dans la joie ; ce menton mal dissimulé par une barbe éparse ; ces dents dont n’aurait pas voulu un Brel. Bien vite, je renonçai à faire la liste de mes défauts : l’éternité n’y aurait pas suffi.
Alors, sentant qu’il n’y avait plus rien qui me retenait à la surface, je laissai mon esprit s’assoupir. Tout était pour le mieux : mon trop jeune corps continuerait d’errer en haut tandis que ma conscience déjà bien fatiguée par ses quelques années d’existence pourrait enfin goûter au repos des Limbes.
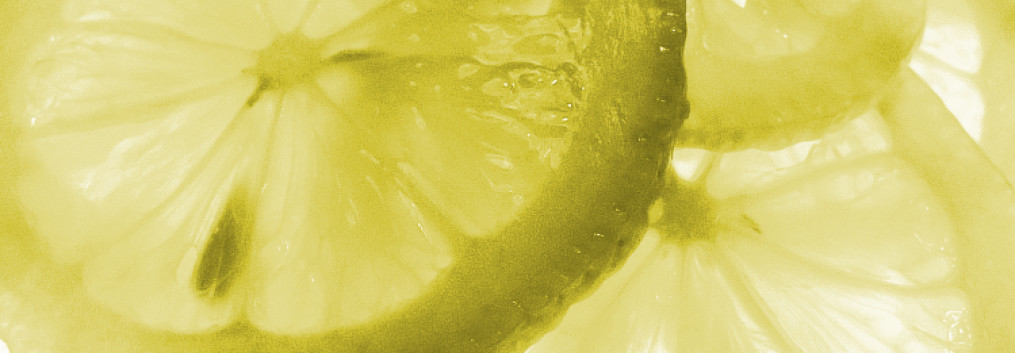
La lumière luit dans les ténèbres les plus profondes. Le 27 décembre commence le printemps. Après les Limbes, il y a la résurrection (dixit M. Saint Jean).
Très beau texte ceci dit. Très dense.