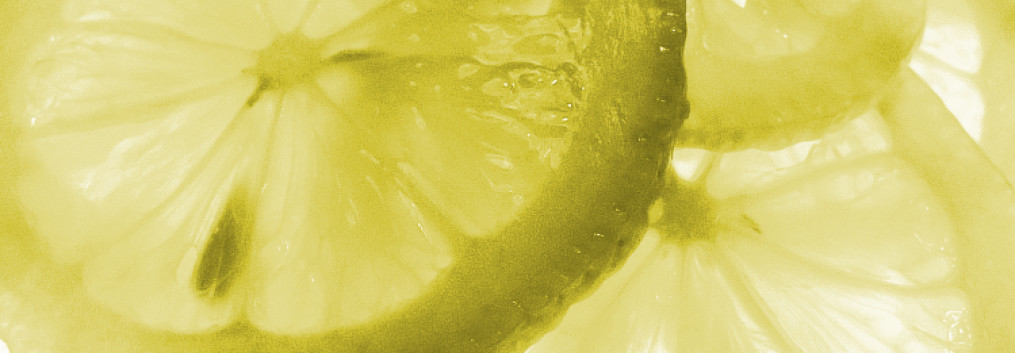Ceux qui me connaissent savent que je ne prête pas facilement le flanc à la fiction. Je suis plutôt du genre terre-à-terre. La réalité est ainsi faite qu’elle est rude pour tous. Vouloir l’éviter est au mieux inutile, au pire absurde. Toujours est-il que ces mots griffonnés au dos de deux billets de train datés pour le premier du dix-huit décembre et pour le second du quatorze octobre m’interpellent. Je les ai trouvé dans la poche d’un manteau acheté d’occasion. L’histoire qui y est contée peut très certainement être fausse. Il n’empêche qu’un petit morceau de conscience en moi y croit. Cette histoire m’obsède à tel point qu’il s’agit plutôt ici de la purger de ma mémoire que de la partager. Je vous les retranscris avec toute la rigueur qui me caractérise.
1/ En me levant hier matin, ma mâchoire était douloureuse. Je ne me rends compte seulement maintenant de cette douleur légère que j’ai dû avoir ignoré sur le moment-même. Ce doit être lors de ma pause, vers treize heure, que la douleur m’est apparue pleinement. J’ai éprouvé des diff[icultés] à terminer le sandwiche (sic) que j’avais acheté. Dans l’après-midi, j’ai bien senti que cette douleur ne s’éteignait pas. On aurait dit que mes joues, comme le reste de ma bouche, se repliaient sur elles-mêmes. Je suis parti plus tôt de mon travail. Au soir, je n’ai pas réussi à avaler quoi que ce soit. J’ai regardé la télévision pour me changer les idées. Rien n’y a fait. Je me suis préparé une soupe et j’y ai fait tremper deux tartines que j’ai avalé[es] avec beaucoup de peine.
2/ Le lendemain matin, la douleur avait presque disparu. Elle devait être redescendue au niveau de la veille au m[atin]. Content de cela, je suis allé me raser. Dans la glace, j’ai vu que ma bouche était bien plus petite que d’habitude. Mes lèvres étaient pincées malgré elles. Je n’arrivais pas à les ouvrir plus grand. J’ai tél[éphoné] au docteur et lui ai expliqué tant bien que mal l’état dans lequel je me trouvais. J’ai terminé de me préparé (sic), très préoccupé, et ai attendu les 17h du rdv. Sur le chemin, j’ai senti que le nez me démangeait, comme si quelqu’un me le pinçait. Dans la salle d’attente vide, j’ai comm[encé] à suffoquer, à avoir du mal à resp[irer], comme une main sur mon visage.
(Concernant le passage qui suit, j’ai dû déchiffrer l’écriture qui n’était plus que lignes tremblantes. J’ai essayé du mieux que j’ai pu de rendre le tout cohérent.)
Tout est arrivé très vite. Trop vite. Je compr[ends] que mon temps est compté à mesure que je peine à respirer. Je n’ai plus la force de me lever. Je ne parviens plus à crier. Mes doigts ont du mal à tenir le bic. Je ne sais pas de quel mal je souffre, mais il est en train de me tuer.
(La suite n’est plus qu’un enchevêtrement de lignes qui se superposent et qui ne font pas sens. Si quelqu’un veut tenter de les déchiffrer, je possède les deux originaux chez moi et peux les faire parvenir très facilement, bien que je ne sois pas sûr que cela en vaille la peine.)