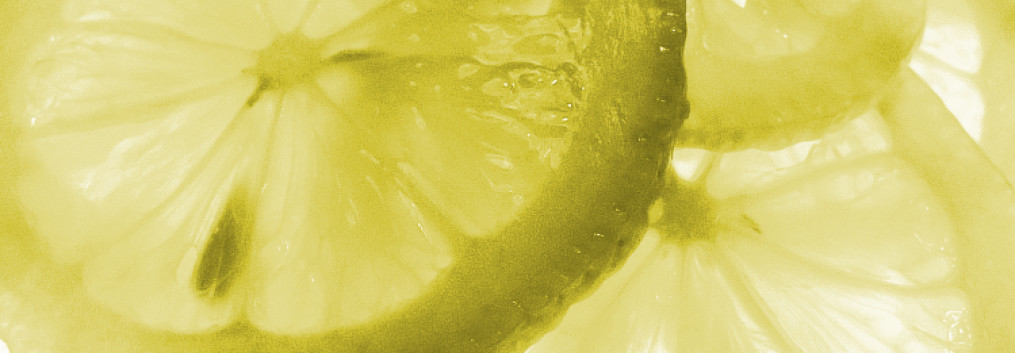Dix-sept heure cinquante-neuf. Il ne reste plus qu’une minute à attendre. Les aiguilles de l’horloge séparent le cadran en deux moitiés identiques. Les portes sont fermées pendant que John sert le dernier client. Il lui jette à la figure son dernier sourire de la journée ainsi qu’un « au revoir » expéditif et le client s’en va poursuivre sa soirée dans un lieu plus plaisant que celui-ci. John n’a plus qu’à compter sa caisse, maintenant. Bientôt, il pourra lui aussi quitter cette cage trop propre. Tandis que ses doigts glissent sur les billets sales et froissés, il espère secrètement ne pas avoir de différence de caisse. Cela le forcerait à recompter et même, dans le cas où sa caisse s’obstinerait à ne pas être juste, il serait obligé à donner des explications à son chef. Ce n’est pas que John se sente coupable de quelque crime. C’est juste qu’il n’a pas envie de perdre du temps en d’inutiles explications. Quand il compte les billets de cinquante euros, une pointe d’anxiété l’assaille. L’idée de rester une seconde de plus que nécessaire dans cet endroit trop blanc pour être honnête lui est insupportable. En jetant un regard en coin aux parois immaculées, il ne se souvient plus s’il se trouve dans une prison, un hôpital ou quelque autre chambre où l’on ne fait que des mauvaises rencontres. Il termine de compter les pièces d’un centime et clique sur « valider ». Il y a une seconde de flottement durant laquelle son cœur arrête de battre. Heureusement, la caisse s’avère être juste, ce soir. John respire avec satisfaction. Le voici libre de regagner ses pénates.
En poussant un bref soupir de soulagement, John prend sa caisse sous le bras et la range dans le coffre. Il se saisit de son sac et de sa veste. En quelques minutes, il est dehors. Pour la première fois depuis plus de huit heures, il voit à quoi ressemble le ciel. Le monde extérieur n’a pas tellement changé depuis ce matin. Il ferme les yeux et respire à pleins poumons l’air vicié du centre-ville, faisant ainsi le plein d’hydrocarbures. Fait étrange : son mal de crâne ne passe pas. Il fronce les sourcils. Cette migraine dure depuis plusieurs jours déjà, comme un étau qui ne se desserre pas. Il marche vite. La tête lui tourne comme s’il était ivre. Il a du mal à voir où il va. Il a l’impression que toutes les rues de Bruxelles se ressemblent et se rassemblent pour le renvoyer dans sa prison. Il se dépêche de monter dans un tram qui passait par là avant que les murs ne murissent leur décision.
Une fois rentré chez lui, John se vautre directement dans le fauteuil, comme si ses forces l’avaient abandonné. il reste ainsi de longues minutes sans bouger. Il reste amorphe, plongé dans une contemplation absurde de la paroi blafarde qui se dresse devant lui depuis de nombreuses années, sans pourtant jamais avoir changé. Il cligne des yeux une fois. Une deuxième fois encore. Avant la troisième fois, son estomac se rappelle à lui : il grogne, l’infâme. Il geint tellement fort que la tête finit par l’écouter et met en branle pieds et mains. Avec des gestes lents, le propriétaire de toutes ces parties s’extrait péniblement du fauteuil. Il arrive à se trainer jusqu’à l’ordinateur. Il attend que celui-ci s’allume sans que ses yeux ne trahissent le passage d’aucune pensée particulière. Après quelques manipulations, il peut enfin passer commande d’un repas. Ce sera indien, ce soir. Une joie indescriptible l’envahit, mais encore une fois, son corps n’en laisse rien paraitre.
Dans une heure, le repas sera là. En attendant que le livreur arrive, John remarque le casque qui se trouve à portée de sa main. Il lui reste au moins une heure à attendre avant que l’on sonne à sa porte. Le verre semi-opaque lance des reflets argentés qui lui font envie. Il n’hésite pas plus d’une seconde et se saisit de l’objet aux formes épurées. Il branche le câble à son ordinateur. D’une main, il dégage ses cheveux négligés et de l’autre, il pose le casque sur sa tête. Il rabat la visière sur ses yeux. Le programme est lancé. Aussitôt, une lumière blanche remplit son champ de vision. Il n’y a d’ailleurs rien d’autre que cette lumière, qui lui ravit les sens. De temps en temps, il y a une variation dans la couleur ou dans l’intensité, mais c’est toujours la même lumière qui lui lave les yeux et le cerveau de tout ce qu’il a vécu aujourd’hui. De cette façon, il sera prêt à supporter une nouvelle journée.
Ce n’est pas que ce qu’il fasse soit pénible ou stressant. Tout au contraire, le travail de John est inconsistant : tout au long du jour, il insère des chiffres et des lettres dans des formulaires, ce qu’une machine pourrait faire mieux que lui. La seule plus-value dont il pourrait se vanter proviendrait des ventes qu’il réussirait à faire sur la journée. Mais pour être honnête, il y en a tellement peu que son employeur ferait mieux de se décider à le remplacer définitivement par une machine.
Il y a bien des décennies, certaines personnes avaient prédit qu’une fois le monde rempli de machines, l’être humain serait débarrassé de la contrainte du travail. John y pense parfois, quand il en a le temps, et se dit que l’humanité a dû échouer quelque part, puisqu’il continue aujourd’hui de s’abrutir à réaliser des tâches qu’un ordinateur pourrait faire mieux que lui. Et ce sont les employés eux-mêmes qui s’opposent à cette évolution, pour le « droit au travail ». Au final, grâce à l’inertie des êtres humains, les machines n’auront apporté que plus d’insécurité. Parce que personne n’a réagi à faire changer un modèle vieux de deux siècles, on emploie des êtres humains comme des machines. Des milliers de personnes se retrouvent dans des emplois sans la moindre goutte de créativité, répétant inlassablement les mêmes gestes, encore et encore, jusqu’à ce que vienne l’âge de la retraite.
C’est cela que John aimerait pouvoir formuler. Mais il n’a pas le temps de dire quoi que ce soit la journée, et quand le soir est là, il n’en a plus la force. Après avoir passé sa vie à faire le travail d’une machine, il se met lui aussi en veille, pour ne plus rien savoir de cette société sans saveur. Il se fond alors dans la chaleur réconfortante et narcotique des lumières du réseau qui le connecte au monde.
Après une heure de béatitude, quelqu’un sonne à la porte de John, mais celui-ci ne l’entend pas. Quelques minutes plus tard, son téléphone portable vibre dans son sac, mais sans plus attirer l’attention de son propriétaire que la sonnette. L’appartement pourrait être vide, cela reviendrait au même. À proprement parler, il n’y a d’ailleurs aucun être vivant entre ces murs froids qu’éclairent une lumière sans chaleur. Finalement, les coups à la porte cessent et le silence revient s’installer en roi et maitre. La nuit tombe. Des dizaines de lumières identiques brillent aux fenêtres des appartements de la ville. Comme un cœur qui palpite faiblement.